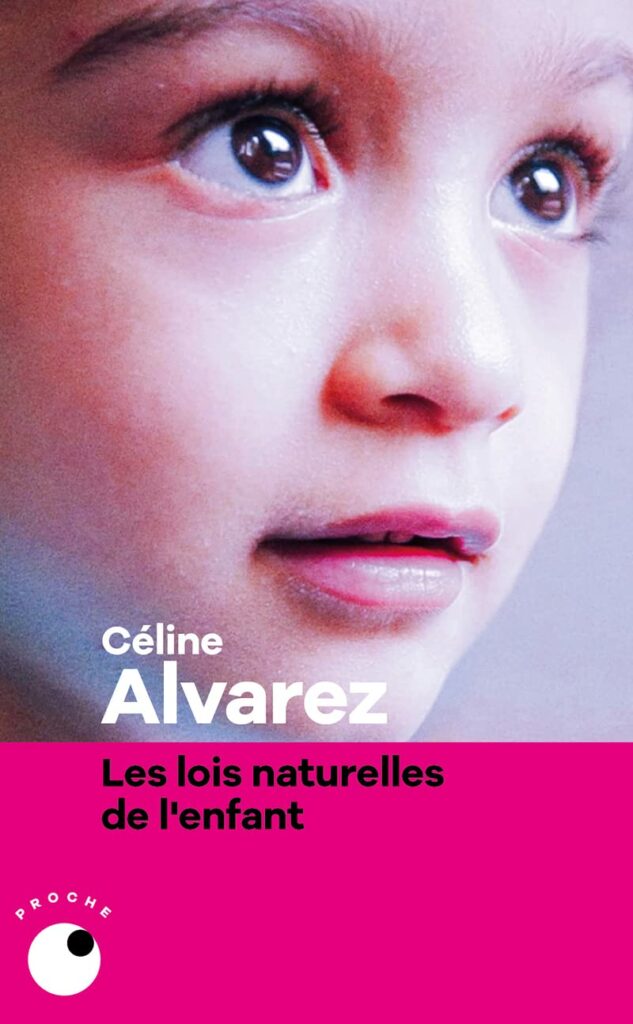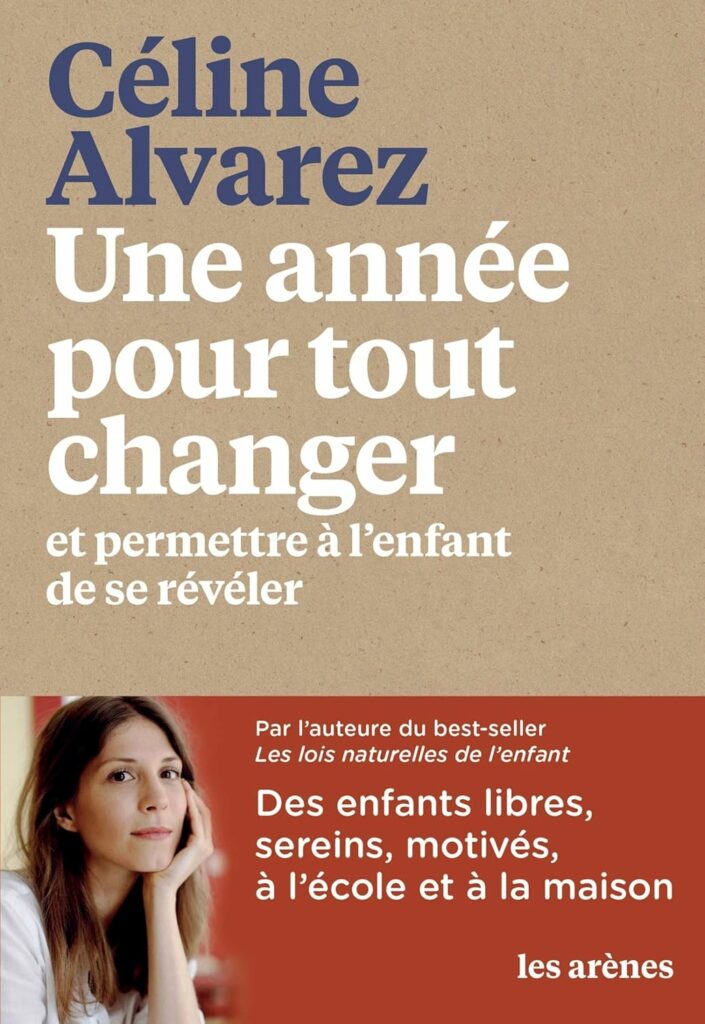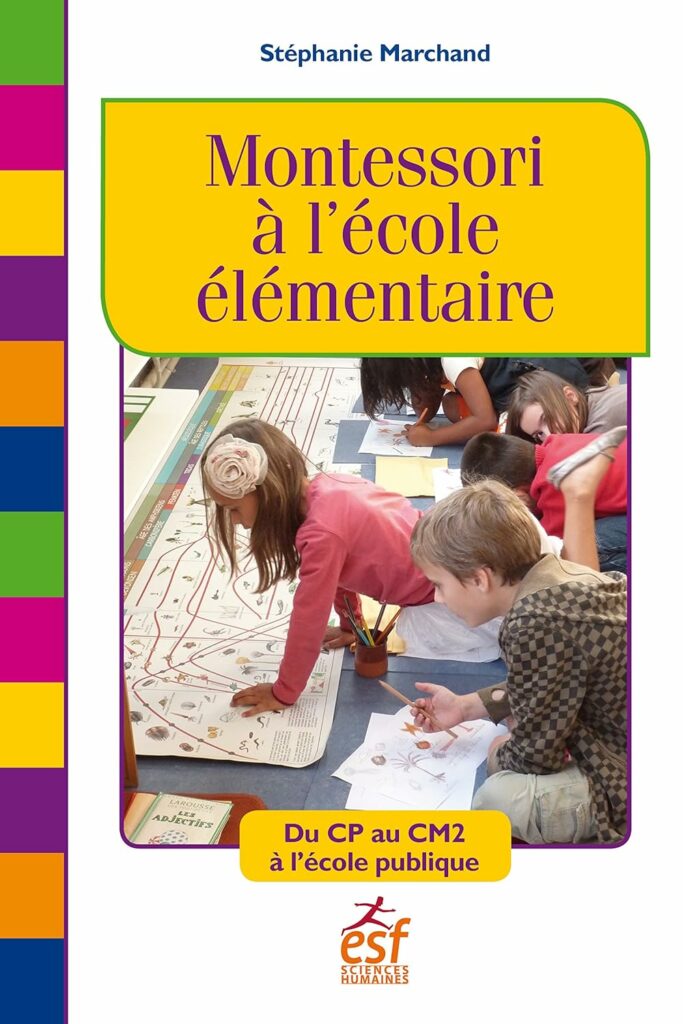Comment préparer sa transition ?
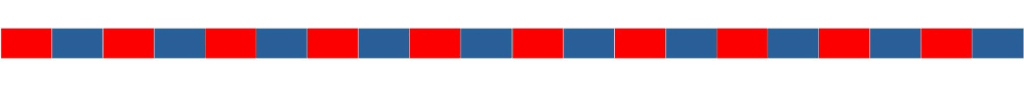
Il y a des moments où on sent que quelque chose ne va plus. Pas forcément de façon brutale, mais un petit tiraillement qui revient souvent…

En 2022, ce tiraillement est devenu trop fort pour que je l’ignore. J’aimais mon métier, j’aimais mes élèves, mais quelque chose clochait. J’avais besoin de retrouver du sens, de la cohérence, de la joie aussi.
Alors j’ai décidé de faire un pas de côté, de repenser ma façon d’enseigner, doucement mais sûrement. Ce n’était pas un coup de tête, ni une grande révolution du jour au lendemain. C’était plutôt un chemin.
Aujourd’hui, j’ai envie de vous raconter comment j’ai amorcé cette transition, ce que ça a changé pour moi, et surtout, comment on peut s’y préparer sans se perdre.
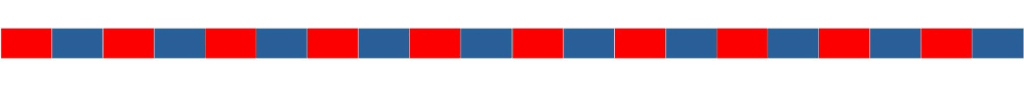
L’année où j’ai (presque) tout changé
Il y a trois ans, j’ai senti que je touchais mes limites. Ma classe de CP fonctionnait de façon assez classique : méthode de lecture clé en main, fichiers de mathématiques… Et même si j’essayais déjà quelques ateliers, je peinais à différencier efficacement : montée des besoins spécifiques, classe très hétérogène, problèmes de concentration, l’impression d’être sans cesse sollicitée (y compris par ceux qui « roulent »). Bref, je rentrais vidée, frustrée, je n’étais même pas satisfaite de ce que j’arrivais à transmettre à mes élèves.

C’est un peu par hasard que je suis tombée, durant l’été 2022, sur la pédagogie Montessori, puis sur l’expérience de Céline Alvarez. Et là, j’ai eu ce déclic, cette direction que je voulais prendre.
Il ne s’agit pas de « tout changer » du jour au lendemain, mais de changer de direction, d’emprunter un nouveau chemin…
Mais avant de bouleverser ma classe, j’ai pris le temps de bien me documenter. Et c’est exactement ce que je vous conseille si vous ressentez, vous aussi, l’envie de changer votre pratique.
Commencer par se former
Quand on découvre Montessori, on a souvent envie de tout changer immédiatement. Mais cette pédagogie repose sur une philosophie profonde qu’il faut vraiment comprendre pour l’adapter à nos contraintes d’école publique. Sans cette compréhension, on risque de ne faire que du « bricolage » sans cohérence.

L’été 2022 a été pour moi un été de transformation. J’ai consacré tout le mois de juillet à m’imprégner de cette approche, et ce n’est qu’en août que j’ai commencé à préparer concrètement le matériel. Cette progression m’a permis d’avoir une vision claire de ce que je voulais mettre en place.
Ma méthode intensive : l’immersion totale
1. Les vidéos
La chaîne YouTube de Céline Alvarez : incontournable !

La chaîne YouTube de Céline Alvarez a été mon point de départ. J’ai littéralement tout regardé : les vidéos théoriques comme les présentations pratiques. J’ai pris des notes, j’ai regardé certaines vidéos plusieurs fois.
Céline Alvarez fait régulièrement référence aux neurosciences. Je suis alors allée voir des vidéos spécialisées sur le fonctionnement du cerveau, les fonctions exécutives, j’ai creusé ces aspects scientifiques. Petit à petit, j’ai construit ma propre vision de la philosophie Montessori.
Cette approche peut sembler chronophage, mais elle est essentielle. Comprendre le « pourquoi » avant le « comment » permet ensuite d’adapter intelligemment la pédagogie à sa classe, plutôt que de copier aveuglément.
2. Les podcasts
Pour gagner du temps, ou ne pas en perdre !

J’ai cherché les podcasts qui traitaient de Maria Montessori mais aussi des autres pédagogies alternatives. C’était parfait pour continuer ma formation pendant les trajets ou en réalisant les tâches du quotidien, beaucoup moins passionnantes !
Cette diversité de formats m’a permis de gagner du temps et d’avoir plusieurs angles d’approche sur les mêmes concepts.
3. Quels livres pour commence ?
Construire sa bibliographie progressive
Parallèlement aux ressources gratuites, j’ai commencé à constituer ma bibliothèque. Attention, je ne dis pas qu’il faut tout acheter d’un coup ! Certains livres ont été achetés plus tard, au fur et à mesure de mes besoins.
Pour débuter : les incontournables
Trois livres m’ont particulièrement aidée à démarrer :
« Les lois naturelles de l’enfant » de Céline Alvarez, qui expose les grands principes du développement et explique comment adapter la classe pour favoriser l’autonomie.
« Une année pour tout changer » de Céline Alvarez, où elle partage son expérience avec 750 enseignants qui ont transformé leur classe sans forcément utiliser du matériel Montessori spécialisé.
« Montessori à l’école élémentaire » de Stéphanie Marchand, qui propose une vision très concrète de cette pédagogie adaptée au CP-CM2 en école publique.
Pour approfondir : quand on est lancé
Une fois la transition amorcée, d’autres ouvrages deviennent précieux pour approfondir les aspects techniques : les manuels « Montessori pas à pas », les guides sur les mathématiques 6-12 ans, les sciences, les grands récits…
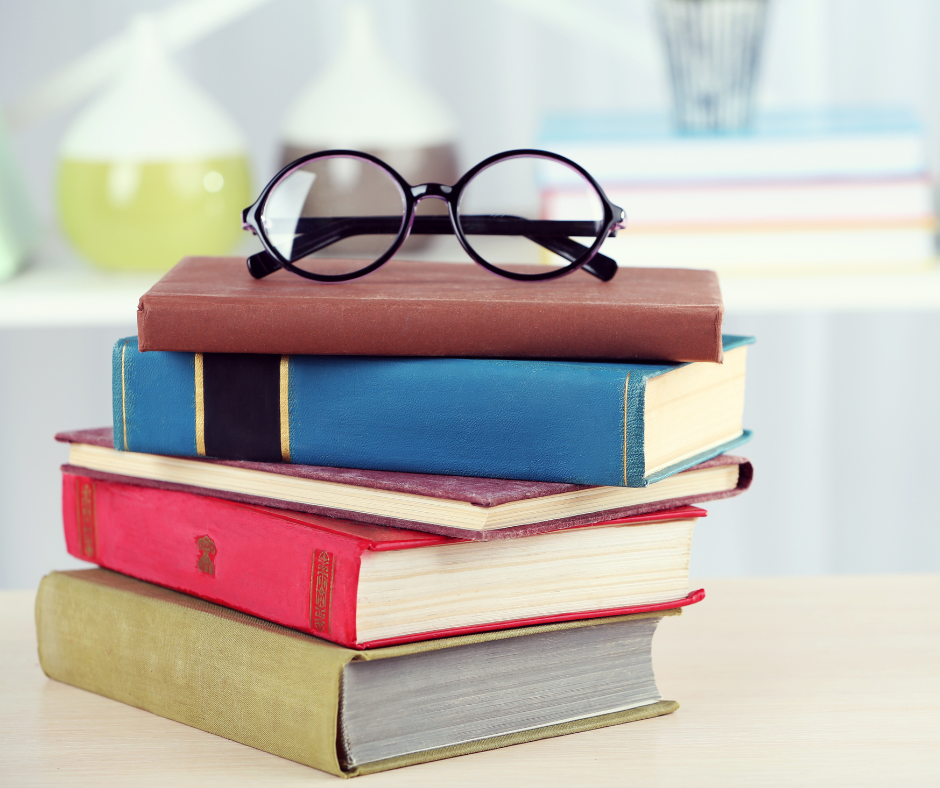
Vous retrouverez ma bibliographie complète avec mes commentaires ici :
4. Les blogs
Et bien sûr, je n’oublie pas tous les blogs de collègues, d’éducatrices, de passionnés de pédagogie Montessori qui peuvent être de vraies pépites. Je vous partage ici ceux que j’aime particulièrement. Cette liste s’enrichira au fil de mes découvertes.

Liste non exhaustive de mes blogs préférés !
Le passage à l’action : août, mois de préparation
Une fois bien imprégnée de la théorie, j’ai pu passer à l’action en août. J’avais une vision claire de ce que je voulais mettre en place, et surtout, je comprenais pourquoi chaque élément avait son importance.

J’ai commencé par fabriquer tout le matériel de mathématiques de base. Ce travail manuel m’a permis de m’approprier encore mieux chaque matériel, de comprendre sa logique de construction.
Retrouvez mes DIY Montessori ici :
Et contrairement à ce qu’on pourrait penser, cette phase de fabrication était déjà de la formation !
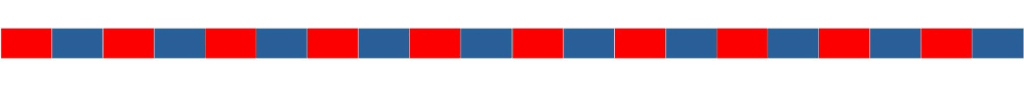
Mes conseils pour bien commencer
Prenez le temps qu’il faut

Ne vous mettez pas la pression de tout comprendre en deux semaines. Cette phase de documentation peut prendre tout un été voire plusieurs mois et c’est normal. Mieux vaut partir sur des bases solides que de se lancer sans recul.
Variez les sources

Alternez vidéos, lectures, podcasts…
Chaque format a ses avantages et s’adapte à votre disponibilité : les podcasts permettent de gagner du temps pendant les trajets, les vidéos offrent une approche visuelle, les livres permettent d’approfondir.
Cette diversité de supports aide à ancrer les concepts sous plusieurs angles.
Notez tout, systématiquement
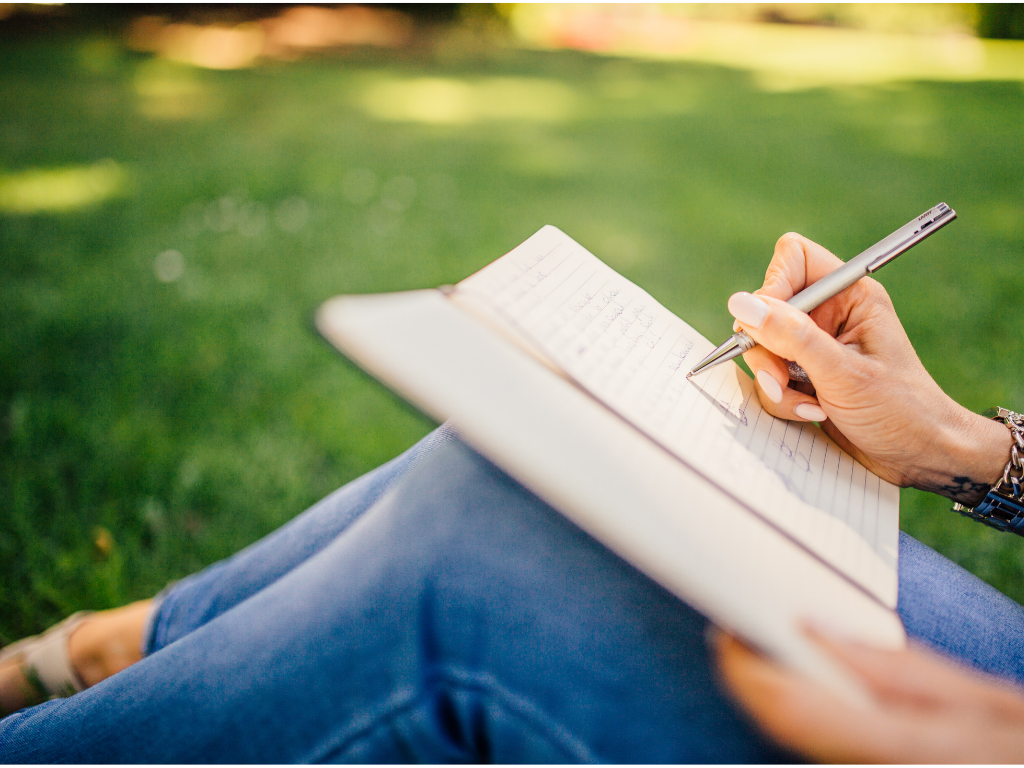
Face à cette surcharge d’informations nouvelles, prendre des notes devient indispensable. Je notais vraiment tout : les concepts découverts, mais aussi mes idées d’organisation de classe. C’est du temps investi qui aide énormément à intégrer toutes ces nouveautés.
Connectez pédagogie et neurosciences

Ce sujet mérite d’être creusé !
Comprendre comment fonctionne le cerveau des enfants donne du sens à chaque choix pédagogique et renforce notre conviction dans cette approche.
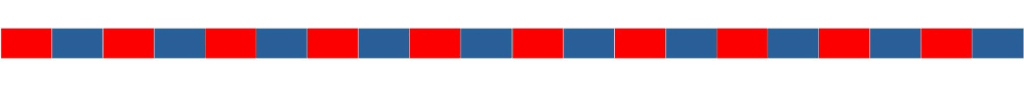
Vous êtes prêt pour la suite ?
Cette phase de documentation intense peut sembler décourageante, mais elle est vraiment la clé d’une transition réussie. Une fois que vous aurez cette base solide, vous pourrez passer aux étapes concrètes :
désencombrer votre classe, développer l’autonomie, organiser vos espaces…

Aujourd’hui, après trois ans de recul, je peux vous dire que ces semaines de formation ont été l’investissement le plus rentable de ma carrière. Ma classe est apaisée, mes élèves avancent à leur rythme, et moi, je me sens enfin alignée avec mes valeurs d’enseignante.
Si vous vous posez des questions sur votre pratique ou si vous ressentez cette envie de changement, vous êtes au bon endroit. Cette transition est possible, même en école publique, même avec les contraintes du terrain. Il suffit de bien s’y préparer.
Dans le prochain article, nous verrons comment passer concrètement à l’action avec la première étape terrain : désencombrer sa classe pour faire place à une nouvelle approche.